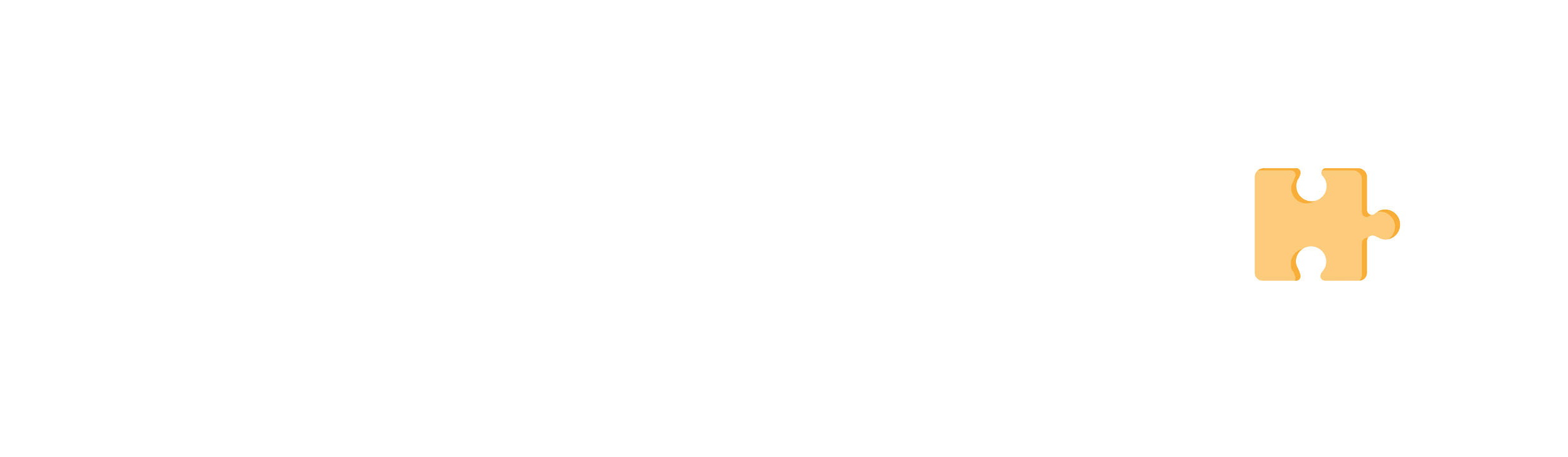
Rencontres des Pratiques Professionnelles
Les Rencontres de Pratiques Professionnelles (RPP) offrent un espace structuré de réflexion et d’échanges autour des pratiques professionnelles, individuelles et collectives. Elles s’inscrivent dans un cadre souple, non formatif et non évaluatif, favorisant la mise en commun des expériences, la confrontation constructive des points de vue et la co-construction de savoirs. En valorisant la diversité des approches et des représentations, elles renforcent la dynamique d’équipe, soutiennent l’enrichissement des pratiques et contribuent à une amélioration continue des accompagnements.
🕖 Durée : 10 séances mensuelles de
3 heures
💶 Tarifs : sur devis
🏢 Lieu : in situ
🗣️ Intervenants : un formateur métier et/ou un formateur pair
📝 Principes fondamentaux
Les RPP offrent un espace de réflexion centré sur les pratiques professionnelles, dans un cadre souple et non normatif, orienté vers le soutien au rétablissement expérientiel des personnes accompagnées.
Elles privilégient l’exploration libre des expériences, la confrontation bienveillante des points de vue et la co-construction des savoirs professionnels.
En valorisant la diversité des approches et des représentations, elles soutiennent l’enrichissement des pratiques, la transversalité des savoirs et le développement de compétences réflexives au sein des équipes.
NB : Certaines situations ou contextes devront nécessiter une reprise dans d’autres cadres (notamment avec les membres de la gouvernance). Ces éléments seront discutés au préalable avec le groupe.
🎯 Objectifs du dispositif
Ouvrir un espace sécurisé pour l’expression et l’exploration des pratiques professionnelles.
Développer une posture réflexive individuelle et collective.
Favoriser le dialogue, la confrontation constructive et la co-construction des savoirs.
Renforcer l’ancrage des pratiques dans une dynamique de rétablissement expérientiel.
Soutenir la cohésion et la transversalité au sein des équipes pluridisciplinaires.
📄 Déroulé des séances
1. Introduction
Objectifs et rappel des principes fondamentaux : l’animateur ouvre la séance en rappelant les objectifs (réflexion et co-construction) et les principes fondamentaux. Si nécessaire, il rappelle les règles de fonctionnement coconstruites lors de la première rencontre.
Temps d’accueil : permet aux participants de se recentrer et de se rendre disponibles pour l’échange.
Amorce de la réflexion : une question ou une phrase ouverte est proposée pour initier les échanges. Par exemple « Quelle situation récente vous a marqué dans votre pratique ? » ou « Quels questionnements ou thématiques émergent actuellement dans votre travail ? ».
2. Temps d’expression libre
Chaque participant est invité à partager librement :
Une situation précise qui a suscité des questionnements, une tension ou une réussite marquante.
Une thématique particulièrement active ou une problématique collective au sein de l’équipe.
L’animateur veille à encourager les contributions, sans contraindre les participants à s’exprimer, tout en faisant émerger les thématiques qui résonnent particulièrement dans le groupe.
3. Exploration collective et co-construction
Une ou deux thématiques ou situations précises, choisies collectivement par consensus à partir des partages du temps d’expression libre, sont approfondies.
4. Clôture et synthèse collective
L’animateur ou un participant volontaire propose une synthèse légère :
Quels points clés ont émergé ?
Quelles connexions ou résonances ont été mises en évidence ?
Chaque participant peut conclure en partageant : un mot-clé, un ressenti, ou une réflexion personnelle sur ce qu’il retient de la rencontre.
🗣️ Rôles et postures de l’intervenant
L’animateur adopte une posture étayante, visant à soutenir les échanges sans les orienter. Il contribue à maintenir un cadre bienveillant, dynamique et collaboratif. Sa posture et sa pratique permettent :
D’encourager l’association d’idées :
Reformuler, questionner, clarifier ou expliciter les propos des participants pour favoriser la verbalisation.
Favoriser et proposer des liens entre les contributions en reliant les représentations, valeurs, éthiques, postures et pratiques évoquées.
De favoriser la mise en perspective :
Inviter les participants à mobiliser leurs savoirs professionnels et théoriques pour enrichir les réflexions du groupe.
D’explorer la résonance :
Demander au groupe de réfléchir à la manière dont une situation précise résonne avec d’autres expériences vécues.
L’animateur peut également nourrir la réflexion en explorant ses propres expériences professionnelles ou théoriques, de manière étayante mais non directive.
De faciliter la co-construction :
Encourager une élaboration collective, sans imposer de conclusions ou de solutions définitives.

